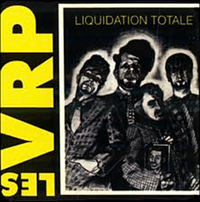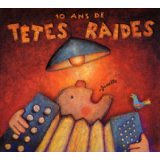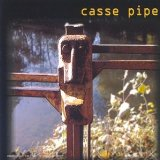La grande et fabuleuse histoire du commerce
8 / 10
Festival TransAmériques
Bonjour à tous,
Le Festival TransAmériques (FTA) offre chaque année au public montréalais, avec le retour des beaux jours, un cocktail de danse et de théâtre de très haut niveau, présentant en particulier, semble-t-il, une liaison directe et privilégiée avec ce que le Festival d’Avignon a proposé de meilleur l’été précédent.
Je vais essayer, dans ce billet, de vous faire part des émotions et des réflexions qu’a suscitées en moi la pièce du brillantissime Joël Pommerat La grande et fabuleuse histoire du commerce, un titre qui constitue en soi tout un programme riche de promesses, mais nous y reviendrons.
Je manquerais toutefois à tous mes devoirs si je ne mentionnais pas tout d'abord, sans m’étendre outre mesure, les trois autres pièces auxquelles j’ai pu assister dans le cadre de ce FTA 2013, en vous laissant le soin d’« interneter », de « googler », de « lire-sur-papier » et de « bouche-à-oreiller » (plus je découvre le potentiel d’ambigüité et de double sens de ce terme que je viens d’inventer uniquement pour vous, plus il me plaît) à loisir pour en savoir plus, en ayant à l'esprit que les spectacles du FTA sont souvent repris, lors de la saison suivante, dans les différentes salles dont nous avons déjà eu l’occasion de parler ici.
Mais revenons à nos moutons… La suite montrera que l’expression est, en l’espèce, particulièrement bien choisie.
En tant que traducteur, je suis, par nécessité et par plaisir, un habitué des dictionnaires; j’aimerais revenir, dans ce billet, sur les définitions que le Grand Robert propose du mot « commerce » et je ne résisterai pas au plaisir d’y ajouter les citations qu’il mentionne également, en espérant qu’elles vous offriront l’occasion de quelques vagabondages littéraires féconds.
Passons sur la première définition proposée par le dictionnaire où le mot commerce désigne les activités liées à la vente et, par métonymie, le monde commercial, et intéressons-nous aux autres acceptions du terme en ayant à l’esprit qu’une polysémie — soyons lacaniens — n’est jamais totalement innocente. Trois autres définitions nous sont proposées qui, mises en perspective avec le contenu de la pièce de Joël Pommerat, me semblent riches de sens et de possibilités d’interprétation.
Le Grand Robert donne donc les trois définitions supplémentaires suivantes :
I Relations que l’on entretient dans la société. ➙ Fréquentation, rapport; relation. Avoir, entretenir un commerce d’amitié. Commerce de galanterie. Rompre tout commerce avec qqn. Fuir le commerce des hommes. Aimer le commerce des livres.
Le commerce des hommes y est merveilleusement propre (à former le jugement), et la visite des pays étrangers (…) pour frotter et limer notre cervelle contre celle d’autrui. Montaigne, Essais, I, xxv, De l’institution des enfants
Nous plaisons plus souvent dans le commerce de la vie par nos défauts que par nos bonnes qualités. La Rochefoucauld, Maximes, 9
Je vous déclare que je romps commerce avec vous. Molière, le Malade imaginaire, iii, 5
La flatterie est un commerce honteux qui n’est utile qu’au flatteur. La Bruyère, les Caractères de Théophraste, De la flatterie.
Mais le commerce de personnages incomparables, — d’un philosophe avec un homme de guerre, d’un poète avec un prélat, d’un historien avec un auteur de romans ou de comédies, d’un diplomate avec un linguiste, n’engage pas les amours-propres et se développe dans toute l’étendue que font deux curiosités croisées entre deux univers. Ce sont ici les différences qui rapprochent. Valéry, Regards sur le monde actuel, p. 294.
II (Dans : … de, d’un commerce, et adj.). Manière de se comporter à l’égard d’autrui. ➙ Comportement, sociabilité. C’est un homme d’un commerce sûr : c’est un homme discret. — Loc. mod. Être d’un commerce agréable.
Vit-on jamais prince d’un commerce plus aisé, plus libre, plus commode? Bossuet, Condé.
C’était un homme de commerce aimable chez qui était resté beaucoup de l’esprit lettré du dernier siècle. Maupassant, Contes de la bécasse, « La bécasse ».
III (Qualifié ou dans un syntagme verbal). Relations charnelles. Commerce adultère. Commerce incestueux. Avoir commerce, ne pas avoir de commerce avec…
Elle (la prostituée chinoise) lui a néanmoins proposé ses services, pour lui faire oublier son malheur, mais il l’a repoussée avec des airs de vertu outragée, disant (…) qu’il ne voulait plus d’ailleurs avoir de commerce avec aucune femme (…) A. Robbe-Grillet, la Maison de rendez-vous.
Notons au passage que si l’allemand ne confond pas Handel et Kommerz, ni l’espagnol commercio et trato, si l’italien réserve commercio aux marchandises et aux valeurs, le français a conservé, pour commerce, la valeur de « relations personnelles » dont l’anglais commerce, à l’inverse de trade, a lui aussi hérité; la subtilité du français ne laisse de me surprendre (enfin, pour être tout à fait honnête, c’est peut-être tout simplement mon manque de maîtrise des subtilités des autres langues qui m’empêche de les percevoir).
La grande et fabuleuse histoire du commerce, comme son titre l’indique, est une pièce axée sur le commerce et, plus particulièrement, sur la vente à domicile et sur ce que l’on appelle des VRP (voyageurs représentants placiers), à ne pas confondre avec Les VRP un groupe de musique parodique français, amoureux de la langue française, auteur d’une musique déjantée et inclassable, une sorte de chanson populaire en délire perpétuel, autant sur un plan instrumental qu’au niveau des textes, parfois comparé à des Frères Jacques sous acide!
L’histoire, si tant est qu’il y en ait une, présente quelques tranches de vie de cinq membres d’une même équipe de vente en tournée en province, chaque fois dans une chambre d’hôtel différente. L’un d’entre eux est nouveau dans l’équipe et est, de plus, totalement inexpérimenté dans le domaine et ne doit qu’au fait d’être le neveu de l’un des vendeurs les plus chevronnés (népotisme — au sens étymologique — quand tu nous tiens) d’avoir pu obtenir ce poste. La pièce se divise en quatre parties distinctes, dont les deux premières se passent en 1968 (ce détail nous est fourni par la télévision qui signale ironiquement que ce jour-là, le drapeau rouge flotte sur l’Odéon) et les deux autres durant les années 2000. On notera que si le scénario reste simple en comparaison avec les autres productions de la Compagnie Louis Brouillard, il offre d’intéressantes perspectives de circularité propres à certaines chansons que l’on peut répéter sans fin comme des boucles infinies; à terme, l’histoire pourrait tout à fait se reproduire.
- Dans la première partie, les quatre vendeurs les plus expérimentés, collègues et se prétendant amis, veulent tenter de battre leur record de vente. Comme des chasseurs revenus de la chasse et affichant leur trophée, ils annoncent chaque soir dans une de leurs chambres d’hôtel leurs meilleurs scores, tandis que le petit nouveau continue de revenir bredouille durant plusieurs semaines. S’en suivent plusieurs démonstrations de techniques de vente visant à former l’impétrant à travers des simulations d’entrée de porte; il s’agit ici de « pénétrer » à tout prix chez le client ou la cliente en « violant » son domicile, Pommerat se faisant un plaisir de brouiller les pistes et d’accentuer la connotation sexuelle, d’une part, en n’utilisant que des vendeurs de sexe masculin et, d’autre part, en les faisant se tromper notre jeune vendeur de façon quasi systématique sur le sexe du client ou de la cliente qui lui (entr)ouvre la porte.
- Dans la seconde partie, les rôles sont inversés. Alors que les quatre séniors reviennent chaque soir en annonçant des performances plus médiocres les unes que les autres, le novice réalise des ventes extraordinaires. Les uns rejettent la faute sur la crise économique et morale que le pays traverse — n’oublions pas que nous sommes en mai 68 — ainsi que sur le pourcentage de chômage croissant, tandis que le jeune vendeur considère qu’il s’agit d’une période où les acheteurs ont besoin d’acheter le produit qui leur est proposé dans le but de se rassurer (on ne découvrira que plus tard qu’il s’agit d’un pistolet d’alarme).
- Dans la troisième partie, l’apprenti VRP — enfin, le même acteur qui interprétait le novice de la première partie, puisque nous sommes dans les années 2000 — est devenu un jeune loup, commercial aux dents longues, expert de la vente qui tente de constituer une nouvelle équipe de quatre quinquagénaires sans expérience. Même si son discours ressemble beaucoup à celui que l’on servit au débutant qu’il jouait précédemment, sa démarche est totalement différente.
- Enfin, dans la dernière scène, le brillant jeune homme apparaît comme un homme détruit qui vient d’être quitté par sa femme; brisé et en pleurs, il recherche une consolation auprès de sa nouvelle équipe; toutefois, seul celui qui vient de se faire virer la veille accepte de le réconforter, les trois autres partant précipitamment vendre pour gagner leur vie.
Cette pièce présente toutes les caractéristiques du travail de Pommerat :
- Une recherche documentaire approfondie, voire l’utilisation de témoignages réels (une technique que nous avions déjà pu admirer à Montréal dans Cet enfant à l’Espace Go, Le petit chaperon rouge à l’Usine C et Les marchands à La Bordée; notons que Brigitte Haentjens a récemment présenté la dernière création de Pommerat, La réunification des deux Corées, un spectacle qui a vu le jour à Paris en janvier dernier, en exclusivité nord-américaine au Théâtre français du CNA à Ottawa, heureuses Ottaviennes et heureux Ottaviens!)
- Une écriture scénique, c’est-à-dire une interpénétration et une imbrication étroite des phases d’écriture et des phases de « jeu ». Pour l’auteur, il n’y a pas de réelle séparation entre l’écriture de la pièce, qui ne serait qu’une sorte de roman dialogué accompagné de didascalies, et son interprétation (mot qu’il récuse) sur scène; Pommerat écrit, à proprement parler, du théâtre « joué ». Nous y reviendrons.
- Un paradoxal sentiment d’étrangeté — en dépit du caractère totalement prosaïque et ancré dans la réalité de ce qui se donne à voir et de ce qui se donne à dire — né de petits décalages et de béances très subtiles successivement proposés aux spectateurs aussi bien sur le plan du jeu, des éclairages, de la mise en scène, que des dialogues.
À un premier niveau d’interprétation, la pièce propose une critique du néolibéralisme individualiste, narcissique, calculateur et totalement exempt de compassion ainsi que de sa perversion des valeurs, et notamment de l’instrumentalisation de la notion de confiance, en particulier lorsqu’il s’agit de vendre « à tout prix ». Cependant, Pommerat n’est jamais didactique et n’affiche pas son opinion sur la question, même si on se doute un peu de ce qu’il pense du sujet. Il tente d’être le moins subjectif possible, d’où le parti-pris du documentaire; ici, pas de discours accusateurs, pas de lendemains qui chantent, pas de recherche de solutions alternatives; nous ne sommes pas dans un théâtre « engagé »; l’auteur fait confiance au jugement critique du spectateur.
Le spectacle, dans la plus pure tradition pirandellienne, propose inversions de rôles et renversements de situation; les « winers » deviennent des « loosers », les « idéalistes » des « cyniques », les « heureux en amour » des « plaqués »; tout ceci étant subtilement mis en valeur par des inversions scénographiques et des jeux de lumière en clair-obscur offrant des changements de perspective et nous invitant à affiner notre regard et notre jugement sur les personnages. Pommerat ne craint ni les malentendus ni les ambigüités. D’ailleurs, Franck, c’est le nom du jeune vendeur — merveilleusement interprété par Ludovic Molière (ça ne s’invente pas), à l’unisson de tous les acteurs de la Compagnie Louis Brouillard (qui porte tellement bien son nom) absolument exceptionnels; ces cinq acteurs jouent chacun un « monsieur Tout-le-Monde » avec un tel naturel qu’on jurerait presque les avoir déjà rencontrés dans notre entourage et, en même temps, avec ce rien d’étrangeté qui nous fait frissonner —, après avoir traité ses formateurs de « pourritures », est quitté par sa copine qui le traite de « matérialiste ». Au spectateur de trancher, Franck finit par devenir un très bon vendeur et par trouver du plaisir au jeu cynique de la vente.
Le choix de faire jouer les mêmes comédiens dans des rôles différents, voire opposés (les « bourreaux » devenus « victimes » — consentantes ou résignées — du système), entraîne chez le spectateur une superposition des personnages qui peut prêter un instant à confusion et confirme qu’une situation comprend toujours son contraire. L’agencement de certaines scènes est implacable et, en jouant avec nos émotions, l’auteur nous laisse face à nos contradictions, à nos présupposés et à nos doutes.
Dans la deuxième moitié, située au début des années 2000, les bons vieux téléphones en bakélite noire à cadran qui dataient la première moitié sont remplacés par des téléphones cellulaires dont Frank, devenu un brillant spécialiste de la vente, fait un usage intensif pour échanger avec sa compagne avec laquelle il file un bonheur parfait et qui finira par le quitter, et le produit vendu n’est plus un pistolet à blanc de défense pour le consommateur de 1968, mais un guide universel des droits fondamentaux de l’être humain destiné au consommateur citoyen des années 2000 : plus que jamais, pour avoir l’air authentique, le vendeur, en bon communicant, doit se soumettre à l’idéologie de son temps, qu’elle soit citoyenne ou verte, s’en faire le hérault et le serviteur soumis. Ici, le filtre de la distance historique n’opère plus et Pommerat nous coince dans une réalité que nous connaissons trop bien : le surendettement de quatre apprentis vendeurs un peu usés, en reconversion et en période d’essai sans solde, dont c’est la dernière chance. Il nous jette à la face quelques questions d’éthique pratique : leur « manager » formateur se comporte-t-il comme « quelqu’un de bien » en les rudoyant et en employant la manière forte, leur permettant, in fine, de se révolter et de réussir à vendre, ou en leur proposant un partage des commissions afin de soutenir le maillon faible du groupe? Y a-t-il nécessairement un « bon » et un « mauvais » comportement? Sommes-nous toujours aussi sûrs de nos positions droite/gauche, réac/progressiste, etc. Le piège s’est refermé, et ça, c’est sacrément bon pour la réflexion. Pouvons nous nier que, comme le dit l’un des personnages : « le commerce c’est la vie » et que si les vendeurs ne vendent plus, alors, les usines ferment, le chômage s’installe et… la vie s’arrête! Vous me direz « commerce équitable », mais ne s’agit-il pas d’un oxymore? Quand on voit aujourd’hui comment ont évolué un certain nombre d’entreprises créées sur des principes d’égalité, de respect et de vie quasi associative, on ne peut que se poser la question.
Je voudrais ici évoquer la figure, à mon avis essentielle, de Ruwen Ogien et de sa théorie de l’« éthique minimale ». L’éthique minimale se présentait initialement sous la forme de trois principes : un principe de considération égale qui nous demande d’accorder la même valeur à la voix de chacun; un principe de neutralité à l’égard des conceptions du juste et du bien personnel et un principe d’intervention limitée aux cas de torts flagrants causés à autrui. Par la suite, Ruwen Ogien a essayé de les réduire à un seul : Ne pas nuire aux autres, rien de plus.
(Tonton Georges avait déjà, il y a longtemps, précisé en chanson : « Gloire à qui n’ayant pas d’idéal sacrosaint se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. »)
Don Juan - Georges Brassens
Finalement, ce que Ruwen Ogien appelle « éthique minimale », c’est une éthique qui exclut les devoirs moraux envers soi-même et les devoirs positifs paternalistes à l’égard des autres. En conformité avec cette conception générale de l’éthique, il soutient la liberté de faire ce qu’on veut de sa propre vie du moment qu’on ne nuit pas aux autres, ce qui implique, entre autres, la décriminalisation de la consommation de stupéfiants, de toutes les formes de relations sexuelles entre adultes consentants, et de l’aide active à mourir pour ceux qui en font la demande.
Quelques mots sur la scénographie — mais ne faudrait-il pas parler ici de « scénophanie » tant Joël Pommerat, dans un procédé qu’il n’est pas le seul à utiliser, mais qu’il a porté à un haut niveau de perfection et dont il a fait l’une de ses marques de commerce, fait surgir chaque situation d’une obscurité mystérieuse —, sur la mise en scène, sur les éclairages et sur certains accessoires.
La transition entre les différents tableaux est marquée par un noir et par la diffusion de musiques. Chaque scène représente une chambre d’hôtel différente au sein de laquelle on peut, en général, distinguer un téléviseur, un lit et une armoire. Les personnages pénètrent sur la scène soit côté jardin, soit par le fond de scène, et la scénographie, comme souvent chez Pommerat, se modifie pendant les noirs avec une rapidité et une discrétion impressionnantes. En revanche, un extrait vidéo sur un écran blanc en devant de scène montrant un enchaînement de routes et de portes d’immeubles représentant une journée de travail en accéléré m’a beaucoup moins convaincu (comme c’est souvent le cas avec les insertions de séquences vidéo dont il faut vraiment qu’elles soient « ultrapertinentes » pour emporter mon adhésion). Le lit constitue le point de rassemblement des vendeurs, symbole de repos et de détente après une journée de labeur, ou de rassemblement à l’aube d’une nouvelle journée. La télévision joue également un rôle capital, en permettant aux personnages, et donc au spectateur, de se projeter dans un contexte social, politique et économique. L’éclairage est produit, soit par des lampes présentes sur scène lorsque l’action se déroule le soir, soit, lorsque l’action se passe le matin, par une lumière blanchâtre en plongée, souvent striée, pour montrer qu’il s’agit de la lumière du jour que laisse passer les fenêtres des chambres. D’une manière générale, comme c’est presque toujours le cas chez Pommerat, l’éclairage est relativement sombre, faisant ainsi ressortir une sensation où se mêlent ambigüité, étrangeté, fantasmagorie et inquiétude. Cette lumière ne permet souvent pas de distinguer réellement les acteurs et nous oblige à les reconnaître à leur silhouette ou à certains traits caractéristiques — le gros, le grand, celui qui porte des lunettes ou le chauve —, les scènes prenant alors une couleur onirique, une impression que l’on a souvent chez Pommerat, notamment à cause de leur enchaînement extrêmement rapide qui constitue une véritable prouesse technique (bravo à tous les techniciens concernés). Cette bascule permanente entre le rêve et la réalité brute (les vendeurs regardent chaque soir la télévision pour suivre l’actualité) est ressentie encore plus fortement grâce à l’exploitation occasionnelle d’une musique (bien) chantée plutôt légère. Globalement, la scénographie, la musique, les décors et la mise en scène concourent à donner une impression de plasticité tout à la fois déroutante et techniquement assez sidérante.
Au-delà de cette analyse d’entomologiste du monde marchand, je crois que Pommerat s’intéresse également, tout simplement, au monde du travail, un thème qui lui est cher. Au fond, nos vendeurs pourraient, en ce qui a trait à l’aliénation que représente le travail — on évoquera ici l’étymologie latine du terme « tripalium » désignant un instrument de torture à trois pieux et la vague de suicides en milieu professionnel que connaît actuellement la France —, tout aussi bien être des comptables ou des ingénieurs. Travailler, c’est accepter, huit heures par jour, de porter un masque et de perdre sa vie à la gagner pour tenter de (sur)vivre. On retrouve ici une nouvelle mise en abyme assez fascinante sur le travail de l’acteur qui, bien entendu, porte, lui aussi, un masque et qui, comme un vendeur, situation ô combien paradoxale, doit être profondément lui-même et doit chercher au plus intime pour se « trouver » et arriver à convaincre/séduire/tromper le spectateur/client.
L’écriture de Pommerat est intelligente, incisive, équilibrée, authentique et pleine d’humour et je ne résiste pas au plaisir de vous en offrir un extrait :
La formation de Franck
Le lendemain dans une autre chambre.
FRANCK. Bonjour, monsieur.
ANDRÉ. Madame.
FRANCK. Pardon! « Madame »…
ANDRÉ. Vous venez pas me vendre quelque chose?
FRANCK. Euh si, mais je suis absolument certain que ça peut vous intéresser. Si vous me laissez vous expliquer de quoi il s’agit, vous allez voir…
ANDRÉ. Pardon, vraiment j’ai pas le temps de voir quoi que ce soit aujourd’hui…
FRANCK. C’est dommage, j’ai un produit vraiment très très intéressant à vous proposer.
ANDRÉ. Vous vendez?
FRANCK. Oui.
ANDRÉ. Vous savez quoi? Y en a vraiment marre des vendeurs.
FRANCK. Mais vous connaissez pas encore ce que j’ai à vous proposer parce que si vous connaissiez…
ANDRÉ. Monsieur, je me suis fait avoir par un de vos collègues y a pas plus tard qu’une semaine alors vraiment... je suis pas d’humeur avec les vendeurs en ce moment... Je suis désolée, j’ai plus confiance.
Il ferme une porte imaginaire et va s’asseoir.
FRANCK. C’est dommage... (Un temps. Maurice vient se placer près de lui.) Bonjour madame…
MAURICE. Monsieur.
FRANCK. Pardon... Monsieur. Est-ce que je vous dérange?
MAURICE. C’est comme vous dites... ! J’ai aucun temps à vous consacrer.
FRANCK. Excusez-moi alors vraiment…
MAURICE. Y a pas de mal.
Il ferme une porte imaginaire et va s’asseoir.
FRANCK. Je me permettrais quand même de... (À tous.) Là vous êtes durs…
ANDRÉ. C’est des gens normaux, personne n’a envie qu’on vienne l’emmerder chez lui... Les gens étaient pas durs hier?
FRANCK. Si... Mais je comprends pas, je suis sympa.
MICHEL (se plaçant devant Franck). Continue.
FRANCK. (hésitant). Bonjour euh…
MICHEL. Madame.
FRANCK. Bonjour madame. Je me permets de vous déranger parce que j’ai envie de vous parler d’un produit extrêmement intéressant.
MICHEL. Vous vendez quelque chose?
FRANCK. Absolument, mais vraiment pas n’importe quoi…
MICHEL. Ça ne m’intéresse pas monsieur, en plus je suis dans de grosses difficultés financières en ce moment.
FRANCK. Ne vous inquiétez pas, on peut envisager toutes sortes de solutions de paiement par crédit.
MICHEL. Pardon? Je comprends pas ! On se connaît depuis quinze secondes, je comprends pas ce que vous me dites…?
FRANCK. Je vous dis que, pour payer, je vous propose toutes sortes de facilités de paiement si vous êtes intéressée.
MICHEL. Vous me connaissez depuis quinze secondes et vous me parlez d’argent et de payer. Vous êtes un petit gonflé, vous!
FRANCK. Je crois pas que je sois gonflé, monsieur.
MICHEL. Madame.
FRANCK. Madame.
MICHEL. Si, vous êtes même sacrément gonflé. Au bout de quinze secondes, on se connaît pas, vous parlez déjà̀ de me faire payer quelque chose. C’est la seule chose qui vous intéresse, l’argent, dans la vie?
FRANCK. Pas du tout, je peux vous parler de ce que je veux vous vendre si vous voulez avant?
MICHEL. Ben oui, ce serait peut-être mieux, vous trouvez pas...? Mais bon, de toute façon, je veux rien acheter, je vous ai dit... Surtout pas à crédit, c’est trop dangereux. Alors ne me faites pas perdre mon temps et ne perdez pas le vôtre non plus... Je vous dis bonne journée, monsieur.
Il ferme une porte imaginaire et va s’asseoir.
Contrairement à d’autres, Joël Pommerat ne rechigne pas à s’exprimer, alors écoutons ce qu’il a à nous dire.
C’est une façon de montrer comment cette activité du commerce, vendre, acheter, activité au cœur même de nos sociétés, influence notre manière de nous penser nous-mêmes. […] Ce qui est passionnant et vertigineux dans le métier de vendeur, c’est que le meilleur savoir-faire, la meilleure technique, pour celui qui l’exerce, c’est l’authenticité. […] Mais si le vendeur doit plus ou moins abuser de l’autre, il doit sans doute avant tout se tromper lui-même, pour « construire » cette fameuse authenticité qui est son meilleur atout. Pour être un vendeur vraiment efficace, il faut forcément y croire.
Au-delà du réalisme et d’une étude sur un métier, ce qui m’intéresse, c’est une question plus vaste : qu’est-ce que le commerce, qu’en est-il de la relation commerciale qui nous unit tous les uns les autres dans nos sociétés occidentales? Qu’est-ce que tout cela a transformé et instauré dans le lien et la relation sociale, humaine, dans un couple, dans une famille, dans un groupe d’amis? Quand on se vend des choses les uns aux autres, quand on pense que l’autre ne fait rien de manière gratuite, qu’il est toujours dans la stratégie, quand, soi-même, on est dans ce rapport-là, cela influe nécessairement sur les rapports entre les hommes. Au-delà d’une espèce de critique un peu simpliste du libéralisme, j’ai envie de comprendre la portée du commerce. Forcément, celui-ci fait évoluer le rapport de confiance entre les individus.
Cette pièce était pour moi une façon de parler et de mettre en scène les valeurs, les idéologies, qui orientent et sous-tendent les agissements humains aujourd’hui. Et la confusion de plus en plus importante qui règne en ce domaine. Une façon de montrer comment cette activité du commerce, vendre, acheter, activité au cœur même de nos sociétés, influence notre manière de nous penser nous-mêmes, notre façon de concevoir ce qu’est un être humain, et nos relations. Je voulais montrer comment la logique du commerce peut générer du trouble et de la confusion dans nos esprits et particulièrement en ce concerne nos grands principes moraux.
J’aimerais maintenant évoquer un certain nombre de pistes qui pourraient permettre d’aller un peu plus loin à partir de cette pièce particulièrement riche.
Mythologies
La coloration très « sixties » de la première partie du spectacle fait irrésistiblement penser à Roland Barthes et à ses Mythologies — à noter une magnifique réédition avec photos, assurément un superbe cadeau pour qui veut découvrir l’œuvre du génial sémiologue — décortiquant les mythes et les structures de la société de l’époque, qui sont en très grande partie encore les nôtres. Barthes y définit le mythe (en accord avec l’étymologie) comme une parole en précisant « le mythe est un système de communication, c’est un message ». Le mythe, pour Barthes, est un outil de l’idéologie, il réalise les croyances, dont la doxa est le système, dans le discours : le mythe est un signe. Son signifié est un « idéologème », son signifiant peut être n’importe quoi : « Chaque objet du monde peut passer d’une existence fermée, muette, à un état oral, ouvert à l’appropriation de la société. » Barthes s’attaque notamment, parmi ses objets d’études les plus célèbres, au catch, aux péplums, à la publicité télévisée pour les lessives (salut Coluche), à la DS, à Marlon Brando, à l’Abbé Pierre, aux martiens, au stack frites, au Guide bleu ou au cerveau d'Einstein.
Individu, Famille, Entreprise et Société
Joël Pommerat n’hésite pas à puiser dans le répertoire du conte (archétype du mythe fondateur de l’humaine condition, voir par exemple Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim) — par exemple avec Pinocchio et Le Petit Chaperon rouge — et ce n’est pas pour rien que son histoire du commerce est « fabuleuse », et dans celui de la tragédie antique : oppositions entre le père et le fils, la sœur et le frère ou la femme et l’homme. Mais, c’est lorsqu’il aborde le social, et plus particulièrement le monde professionnel, qu’il se fait le plus pertinent. Le milieu du travail est au cœur de sa trilogie élaborée entre 2004 et 2006 — Au monde, D’une seule main et Les Marchands : ces trois textes questionnent, à travers des personnages torturés, le monde du travail, non pas d’un point de vue social, mais du point de vue métaphysique, c’est-à-dire sur le plan de la place qu’occupe la vie professionnelle dans la vie de l’individu et du rapport au temps qui en découle. Les relations entre employeurs et employés présentées sous des aspects très différents dans les deux dernières pièces de l’auteur, Cercles/fictions et Ma chambre froide, constituent un prolongement de l’univers familial, que nous avions par exemple découvert dans Cet Enfant, tout en l’ancrant dans une société néolibérale presque caricaturale avec ses entreprises ineptes, ses crises sociales, ses journaux télévisés et sa téléréalité.
Banalité, Ambigüité, Trouble et Mystère
Les textes et les mises en scène de Pommerat sont traversés par des « troubles » incarnant un théâtre jouant sur le secret et le mystère naissant notamment de l’indétermination des corps plongés dans la pénombre, mais aussi de l’opacification des situations et des rôles. La banalité des situations déborde (subtilement et légèrement) sur le spectaculaire, l’étrange et le monstrueux : l’ordinaire des douleurs familiales ou de la souffrance au travail induit un vertige onirique. Pommerat s’ingénie à créer une atmosphère étrange et irréelle, mêlant pénombre et métamorphoses.
Une écriture scénique, un artiste total
Dans la conception habituelle du théâtre, le texte est premier, et sa transformation en spectacle scénique relève de ce qu'Antoine Vitez appelait « traduction ». (Vous pouvez écouter ou télécharger ici une intéressante émission de la télé suisse romande sur Vitez.) Joël Pommerat aborde le spectacle à travers la totalité de ses composantes, en refusant une hiérarchie prédéfinie établie depuis ou autour du texte. Ce primat du texte découle en partie de l’histoire de la mise en scène et du rôle joué à l’origine par le metteur en scène. Au fur et à mesure de l’évolution des techniques scéniques, le metteur en scène a émergé comme un artiste complet utilisant toutes les syntaxes et toutes les grammaires à sa disposition pour créer un spectacle total. Pommerat incarne parfaitement cette évolution : chez lui, la scène n’est plus « au service du texte », mais le lieu même de la création. Son écriture scénique, en ne séparant pas le travail sur le texte du travail des acteurs (qui participent largement à la création) et du travail de la mise en scène, lui permet, en interpénétrant simultanément toutes les composantes de la représentation, de se définir ni véritablement comme un auteur, ni véritablement comme un metteur en scène, mais de créer un nouveau statut de « théâtraste » à l’image du statut de cinéaste.
Il s'agit sans conteste d'un moment de théâtre exceptionnel dont vous sortirez certainement profondément bouleversé (à tous les sens du terme)!
Je voudrais terminer avec une citation du prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz, promoteur du Bonheur intérieur brut qu’il souhaite substituer au Produit intérieur brut
Le capitalisme néolibéral est devenu une jungle impitoyable où l’on a oublié que l’être humain devait être au cœur du développement économique et que le profit ne devait pas être un but en soi.
Selon vous, un capitalisme et un commerce moralisés — qu’il s’agisse de commerce international ou de commerce de proximité — sont-ils possibles?
J’attends de vous lire avec impatience.
À bientôt,
Michel